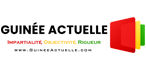R éagissant au rejet par la France de tout dialogue entre les autorités maliennes et les groupes jihadistes, le respectable Imam Dicko a fait une déclaration à la fois empreinte de sagesse et de controverse : « Après vingt ans de guerre en Afghanistan, les Américains ont dû se résoudre à dialoguer avec les Talibans ; pourquoi les Maliens ne dialogueraient pas entre eux ? Ce n’est pas à la France d’imposer sa solution. »
Elle a de la sagesse en ce sens qu’elle rappelle la vertu du dialogue dans toute entreprise humaine, surtout après un conflit armé. Il est encore plus vrai que tout processus de confrontation entre parties ne trouve de résolution viable qu’à travers un processus politique, un dialogue.
Lorsque Henri Kissinger fut chargé par le Président Nixon d’élaborer un plan de retrait américain du Vietnam, le diplomate était mû entre autres par un certain nombre de vues qui imposèrent la discussion avec l’ennemi: les limites de l’action armée, les profits d’une paix honorable, l’évitement d’une défaite formelle des Etats-Unis. On sait, en effet, dans l’histoire militaire, qu’une grande armée qui ne vainc pas, perd ; qu’une petite armée qui n’est pas vaincue, gagne. En l’espèce, une paix négociée avec les groupes terroristes est plus honorable pour l’Etat malien qu’une victoire improbable à long terme.
La déclaration pose cependant controverse en prenant en compte les impératifs du partenariat avec la France dans la lutte contre des groupes armés du Nord. Quelles que soient intentions légitimes, un Etat ne saurait mettre en œuvre une politique étrangère souveraine lorsqu’il est en partenariat stratégique (surtout militaire) car la prise en compte des intérêts de l’allié est une déterminante fondamentale de ses actions. Or, quoiqu’on en dise, en l’état, les ressources de l’Etat malien ne lui permettent de faire face, de manière souveraine et efficace, à la déstabilisation d’une grande partie de son territoire. Et, en pareille circonstance, le respect des alliances étrangères devient une question de realpolitik.
Au demeurant, la question du Sahel a besoin d’être internalisée au sein des politiques de sécurité des Etats de la sous-région qui doivent nécessairement aller vers l’autonomie stratégique. Avec un PIB de plus de 700 milliards de dollars, une population de 350 millions, des défis sécuritaires structurels, l’Espace dépense relativement peu pour sa sécurité. Même le Nigéria, pourtant première puissance économique du continent, ne figure pas dans le classement des dix premières dépenses militaires d’Afrique en proportion de PIB.
Selon les chiffres la SIPRI-Stockholm, les dépenses militaires en Afrique subsaharienne (21,6 milliards USD) représentent 1,3 % des dépenses militaires du monde. L’Afrique de l’Ouest, elle, pèse moins de 20 % des dépenses effectuées en Afrique subsaharienne. De même, les dépenses militaires totales des pays du G5 Sahel représentent 1,2 milliard de dollars US, soit à peine plus que le coût annuel de la MINUSMA.
Or, pour aller vers l’autonomie stratégique, les Etats doivent aligner l’usage de leurs ressources aux menaces qui sévissent dans la sous-région, mais surtout les mutualiser dans le cadre d’une coopération renforcée aux plans stratégique et opérationnel.
Ces choix stratégiques demandent également des arbitrages entre les secteurs classiques de développement économique et social. Ce qui, idéologiquement, sera source d’affrontement avec la toute-puissance communauté des experts en développement.
Mohamed Nasser Keita, conseiller diplomatique