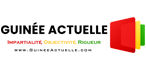D e la poudre au pétrole : la vraie bataille de Bamako.
Alors que Bamako expose chars et blindés pour son 65ᵉ anniversaire d’indépendance, la réalité du terrain révèle une vulnérabilité inattendue : la dépendance totale du Mali à ses corridors pétroliers.
Face à cette faille, les groupes armés déplacent le champ de bataille vers une guerre du carburant; révélatrice d’une tendance universelle où la logistique énergétique devient une arme stratégique.
𝗟𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘅𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗿𝗮𝗿𝗺𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘃𝘂𝗹𝗻é𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲
Le 22 septembre 2025, la junte malienne a célébré le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance par un grand défilé militaire à Bamako, exposant chars flambant neufs, blindés et artillerie lourde.
Mais derrière cette démonstration de puissance se cache une fragilité cruciale : l’armée dépend entièrement de carburants importés par des corridors vulnérables.
𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼𝗿 𝗽é𝘁𝗿𝗼𝗹𝗶𝗲𝗿, 𝗰𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲
Pays enclavé, le Mali importe l’essentiel de ses produits pétroliers via quelques axes stratégiques :
- Dakar – Kayes – Bamako (Sénégal)
- Abidjan – Sikasso – Bamako (Côte d’Ivoire)
- Flux secondaires du Ghana, Niger, Bénin, Togo
Ces corridors sont les artères vitales de l’économie et de l’armée.
L’absence de stock stratégique suffisant – couvrant seulement quelques semaines – transforme chaque perturbation en risque de paralysie.
𝗟𝗲 𝗝𝗡𝗜𝗠 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗮𝘀𝘆𝗺é𝘁𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂 𝗴𝗮𝘀𝗼𝗶𝗹
Depuis septembre 2025, le JNIM concentre ses attaques sur les convois de carburant :
- 8 septembre : proclamation d’un blocus et premières attaques
- Fin septembre : près d’une centaine de véhicules détruits ou neutralisés
Cette stratégie vise à tarir l’approvisionnement, provoquer des pénuries, alimenter la flambée des prix et accentuer la pression sociale sur Bamako.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗿𝗺𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲
Les effets sont rapides :
- pénuries locales à Mopti, Kayes et Gao
- files d’attente interminables aux stations
- hausse du coût des transports et de l’alimentation
- essor du marché noir
Dans ce contexte, le stress énergétique devient une variable politique : il alimente la défiance et fragilise la légitimité de l’État.
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝘁é 𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗲𝗻𝗷𝗲𝘂 𝗱é𝗰𝗶𝘀𝗶𝗳
La crise met en évidence une équation stratégique : un arsenal moderne ne garantit pas la puissance si la logistique énergétique reste vulnérable.
La souveraineté logistique apparaît désormais comme une condition centrale de la souveraineté militaire.
𝗟𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲
Cette crise illustre une évolution des conflits contemporains : la puissance militaire ne peut plus être dissociée de la sécurité énergétique.
Le cas malien révèle que l’accumulation d’armes conventionnelles peut être neutralisée par une fragilité logistique.
Plus largement, de l’Ukraine au Sahel, du Proche-Orient à l’Asie, la continuité des flux énergétiques conditionne désormais l’efficacité des armées.
Le Mali devient ainsi un cas d’école : dans la guerre moderne, le litre de gasoil est aussi stratégique que le blindé qu’il alimente.
𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗟𝗢
𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 é𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲