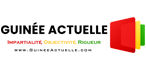L es bailleurs de fonds sont-ils aveugles aux réalités du terrain sahélien ? C’est ce qu’avance Jean-Pierre Olivier de Sardan dans une tribune récente dans laquelle il interpelle les intervenants extérieurs au Sahel, faisant le parallèle entre militaires et développeurs.
Selon son analyse, ces intervenants ‘’se heurtent à la même épreuve de contextes locaux qu’ils méconnaissent, épreuve qui tourne souvent à la revanche de ces contextes’’.
Bailleurs de fonds : un empilement de connaissances
Ce constat d’« incompétence sur les contextes locaux » de la part des « développeurs » est d’ailleurs une des thèses principales, et l’inspiration du titre, de son ouvrage récent La revanche des contextes, somme de plusieurs décennies de recherche sur le terrain.
Précisons que Jean-Pierre Olivier de Sardan nous parle d’une partie spécifique mais importante, en particulier au Sahel, de l’activité des bailleurs qu’il nomme « l’ingénierie sociale » et qu’il définit comme « tous les dispositifs d’intervention planifiée, élaborés par des experts, visant à implanter ou modifier des institutions et/ou des comportements dans des contextes variés ».
Cette thèse ne peut que déconcerter les bailleurs de fonds. Est-il vraisemblable que ces derniers puissent autant méconnaître le terrain, et particulièrement le terrain sahélien, alors qu’ils disposent de dispositifs importants sur place, qu’ils intègrent en leur sein des départements de production de recherche et de connaissances, qu’ils sont souvent impliqués dans des démarches de banque de connaissance ou d’institutions apprenantes ? Sans oublier que leurs moyens leur donnent accès aux meilleurs spécialistes et à la meilleure information. Au sein des agences de coopération, on entend plus souvent déplorer l’empilement des études, des informations et des connaissances de toute sorte que leur rareté.
Un sujet vieux comme le développement
Un premier élément de réponse tient certainement au type de connaissances que les bailleurs de fonds privilégient, donnant une très large place aux macroanalyses, à l’économie, aux comparaisons transversales, au quantitatif, etc. Cela peut amener à sous-valoriser un certain besoin de connaissance fine de type socio-anthropologique, spécifique à des terrains particuliers.
C’est en fait une recommandation ancienne et récurrente au sein des organismes de coopération que d’organiser le recours à des savoirs de terrain lors de la conception et la mise en œuvre des actions de coopération. La « bonne pratique » des études systématiques de contexte, préalables aux opérations, largement promue dans les zones de fragilité, relève de ces dispositions.
L’inclusion d’un « sachant » de terrain dans les équipes de projet, dont on trouve la trace dès 1951 concernant les programmes américains d’aide en Inde (lire, à ce propos, Louis Minielier : « The Use of Anthropologists in Foreign Aid Programs ». Human Organization. Vol 23, 1963), est également une idée récurrente sous différentes formes. Jean-Pierre Olivier de Sardan la renouvelle dans son ouvrage en préconisant le recours à des « experts contextuels », acteurs locaux capables d’une certaine prise de recul et acteurs de changement. On ne peut que souscrire à ce type de dispositifs qui permet de renforcer la connaissance de terrain au sein des actions de coopération, et notamment sous la forme novatrice préconisée par Jean-Pierre Olivier de Sardan.
Mais ce type d’association se révèle souvent difficile à faire fonctionner en pratique, les sachants peinant à trouver leur place dans les dispositifs opérationnels. Cela nous amène à la thèse centrale de notre propos : le problème des bailleurs de fonds ne tient pas prioritairement à un manque d’accès à la connaissance de terrain, il est dans la capacité à mobiliser cette connaissance dans son activité opérationnelle. Deux mécanismes sont à l’œuvre pour expliquer un tel constat.
Une redevabilité qui éloigne du terrain
Le premier mécanisme tient à la nature de la redevabilité des actions de coopération. À tous les stades d’une intervention de développement (de la conception aux résultats), de nombreux flux d’information (concept note, note de projet, tableaux d’indicateurs, reportings, évaluations, etc.) sont produits et portés à examen collectif pour alimenter ce processus de redevabilité.
La densification et la complexification de ces flux d’informations sont sans doute un phénomène marquant commun à l’ensemble des bailleurs de fonds ces dernières décennies. Mais en ce qui concerne la coopération avec les pays tels que les États sahéliens, la chaîne de redevabilité ne se déploie que vers des instances propres aux bailleurs et à leurs mandants : instances hiérarchiques, comités décisionnels, ministères de tutelle, parlements, société civile, etc.
Ce déséquilibre de la redevabilité engendre une conséquence sur le traitement de l’information et des connaissances : la connaissance spécifique à un contexte, complexe et peu familière à ces instances, y est mise en concurrence, souvent à son détriment, avec toutes sortes d’informations de nature différente : positionnement stratégique, tableau de bord, priorités sectorielles ou thématiques, caractère d’innovation, complémentarité avec d’autres politiques ou actions, impacts attendus, etc. Le décentrage de la discussion et de la décision, dès le démarrage puis tout au long d’une intervention, au sein d’instances « lointaines » ayant leur propre agenda, filtre progressivement la mobilisation de la connaissance fine spécifique au terrain concerné.
Une méconnaissance utile du terrain ?
Un second mécanisme s’inscrit dans la primauté donnée dans la culture des institutions de coopération à l’action sur la connaissance. Dans un monde idéal, l’action est d’autant plus facilitée que l’on connaît dans toutes ses dimensions la situation d’intervention. La réalité est tout autre : en matière d’ingénierie sociale, car rappelons que nous ne parlons ici que de cela, la connaissance fine du terrain peut avoir un effet de mise en doute de l’action, voire un effet paralysant. Certains analystes (Mark Hobart ou Jean-Pierre Jacob) ont été jusqu’à évoquer un voile d’ignorance comme facilitateur de l’action.
Tandis qu’une théorie du changement simplifiée peut facilement mettre en lumière les impacts positifs d’une intervention, la connaissance approfondie d’un contexte peut être de nature à rendre les décisions et les arbitrages plus difficiles, s’appliquant à la complexité du réel. Comment bien agir quand on sait qu’une intervention entraînera des gagnants et des perdants, que ses impacts sur les relations entre groupes seront indécis ou encore que les incitations seront en partie contournées, etc. ?
Il est ainsi souvent plus difficile d’agir en toute connaissance de cause qu’à partir d’une appréhension du terrain sous forme de faits stylisés. Toutefois, ce « paradoxe » trouve certainement ses limites. Si la connaissance peut être contrariante, c’est aussi qu’elle peut conduire à des pistes d’intervention qui, compte tenu des contraintes opérationnelles, souvent sortent du champ des réponses mobilisables. Par exemple, quand des pistes d’actions peuvent s’écarter du sacro-saint instrument d’action dans le monde du développement qu’est le « projet ».
En effet, si la connaissance peut se heurter à l’action en matière d’ingénierie sociale, c’est parce qu’elle conduit souvent à la préconisation d’actions trop complexes, trop modestes, trop patientes, trop négociées, trop risquées, trop locales, trop incertaines, trop originales pour entrer dans le champ des développeurs. Pour ouvrir la possibilité de ces réponses spécifiques, il faudrait que la connaissance du terrain conditionne la définition du champ des possibles. C’est la condition de sa pleine mobilisation. À défaut, elle est souvent l’objet d’une utilisation « instrumentale » et limitée, c’est-à-dire qu’elle n’est mobilisée que lorsqu’elle précise, complète ou légitime une action en partie prédéfinie.
Vers une meilleure mobilisation de la connaissance
Ces deux hypothèses – redevabilité déséquilibrée et primauté de l’action sur la connaissance – sont de nature à éclairer le paradoxe d’une (apparente) méconnaissance du terrain par les bailleurs de fonds. Ces mécanismes seraient en partie à la source du succès des « modèles voyageurs », peu adaptés au terrain, que Jean-Pierre Olivier de Sardan analyse dans son ouvrage.
Il serait intéressant, pour reboucler sur l’argumentaire initial de Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui faisait le parallèle entre développeurs et militaires, de questionner si ces hypothèses de redevabilité déséquilibrée et de primauté de l’action, issues de l’expérience de l’ingénierie sociale du développement, ont aussi un pouvoir explicatif dans le domaine des interventions militaires.
Les voies pour remédier à cette insuffisance de la mobilisation de la connaissance de terrain se déduisent en creux du diagnostic. Le rééquilibrage de la redevabilité au profit des acteurs locaux est une première piste qui nécessiterait que les acteurs de terrain ne soient pas de simples pourvoyeurs d’information mais bien des codécideurs en matière d’ingénierie sociale. Une seconde piste est l’inversion du lien de primauté entre connaissance et action, qui conduirait, sous le pilotage de la lecture du terrain, à ouvrir la boîte des modalités de coopération plus largement, et notamment bien au-delà du projet.
Pourrions-nous alors cette fois-ci à notre tour prendre notre revanche sur les contextes ?
Jean-David Naudet, chargé de recherche à l’AFD