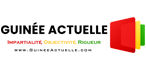E n Guinée, la récente décision des autorités de fermer 1 724 unités de production d’eau sur les 3 100 recensées dans le pays continue de susciter des réactions, a-t-on constaté.
Cette mesure, motivée par le non-respect des normes sanitaires, vise selon les responsables à garantir une meilleure qualité de l’eau pour les populations. Mais sur le terrain, elle soulève des préoccupations quant à ses impacts sociaux et à sa mise en œuvre.
De nombreux observateurs s’interrogent sur les conséquences immédiates de cette décision, notamment pour les citoyens qui dépendaient de ces unités privées pour leur approvisionnement quotidien.
Dans plusieurs quartiers, où l’accès à l’eau potable reste limité, ces unités comblaient tant bien que mal les insuffisances du service public.
En l’absence d’un plan de transition clairement défini, certains estiment que la mesure pourrait aggraver les difficultés d’accès à l’eau dans certaines zones urbaines et rurales. Une situation d’autant plus préoccupante que la Société des Eaux de Guinée (SEG), principal fournisseur public, est régulièrement critiquée pour la qualité et la régularité de sa distribution.
Certains acteurs pointent également une forme de déséquilibre dans l’application de la mesure. Alors que les unités privées sont sanctionnées pour non-conformité, la SEG, malgré les nombreuses plaintes des usagers, ne semble pas concernée par cette vague de fermetures. Une situation qui alimente le sentiment d’injustice chez certains citoyens.
Pour plusieurs observateurs, l’enjeu ne réside pas dans la légitimité de la démarche – car la sécurité sanitaire est une priorité indiscutable – mais dans les conditions de sa mise en œuvre.
Beaucoup estiment qu’il aurait été plus judicieux d’accompagner les unités concernées vers la mise aux normes, plutôt que de procéder à des fermetures massives sans solutions alternatives concrètes.
Dans un pays où l’accès à l’eau potable reste un défi quotidien pour de nombreux ménages, la décision des autorités, bien qu’animée par des considérations sanitaires, rappelle la nécessité d’une approche plus inclusive et progressive.
L’État est en effet attendu non seulement dans son rôle de régulateur, mais aussi dans sa capacité à soutenir les acteurs locaux tout en garantissant un service public efficace.
En définitive, cette opération de fermeture pose une question de fond : comment concilier exigences sanitaires et impératifs sociaux dans un contexte de fragilité structurelle ?
La réponse à cette équation complexe pourrait bien déterminer la réussite – ou non – de cette politique de réforme dans le secteur de l’eau.
Alpha Binta Diallo